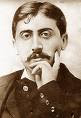Nathalie Elgrably-Lévy
Le Journal de Montréal, p. 29
05 mars 2009
Dans ma chronique de la semaine dernière, j’ai associé l’effondrement du Dow Jones aux politiques de l’administration Obama. Évidemment, comme chaque fois que j’exprime mon opinion sur les politiques du nouveau président, j’ai droit à une avalanche de courriels haineux dont le ton laisse supposer des expéditeurs ensorcelés par les incantations du leader américain, et programmés pour défendre son message. Manifestement, dans certains cercles, Obama est un dieu, douter de ses initiatives est un sacrilège, et désapprouver ses politiques, un péché capital!
Certes, chacun est libre de déifier la personne de son choix. Mais vouloir bâillonner quiconque n’adore pas le gourou ou ne pratique pas le culte, est une manœuvre inquisitoriale inacceptable dans une démocratie moderne. J’entends donc bien faire respecter mon droit de me dissocier du délire collectif, de refuser d’idolâtrer le nouveau président, et de décliner l’invitation à m’autocensurer. En revanche, je continuerai à apprécier Barack Obama pour ce qu’il est, soit le président des États-Unis, ni plus, ni moins. Et si ses prédécesseurs ont eu droit à la critique et à des propos quelquefois vitriolés, pourquoi Obama devrait-il être épargné?
L’équipe Obama est certainement très bien intentionnée. Mais les mesures adoptées depuis quelques semaines achèveront une Amérique déjà fragilisée. Dans le contexte actuel, il est impératif d’encourager la production. Pour y arriver, il faut stimuler l’investissement et inciter les entrepreneurs à prendre des initiatives. Or, ce n’est pas en augmentant l’impôt sur les gains en capital et sur les dividendes que Washington y parviendra, bien au contraire.
Il faut également augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. Or, abolir les coupures d’impôts votées en 2001 et 2003 est une mesure contre-productive, car elle alourdit le fardeau fiscal des Américains. Globalement, les hausses d’impôts avancées par l’équipe Obama auront pour effet de décourager le travail, l’épargne, l’investissement et l’entrepreneurship, avec pour conséquences d’allonger et d’aggraver la récession, d’imposer une reprise lente et modeste, et de réduire la compétitivité des industries américaines. Obama affirme vouloir combattre la crise économique mais, par ses initiatives, il a déclaré la guerre à la prospérité!
Pis encore, il a endossé un tsunami de dépenses. À titre comparatif, les plans de sauvetage et de relance des dernières semaines ont coûté l’équivalent de 15 guerres en Irak. Certains affirment que les dépenses de l’État sont indispensables pour dynamiser une économie amorphe. C’est faux. George W. Bush a dépensé plus que n’importe lequel des ses prédécesseurs. Il a été incontestablement le président le plus interventionniste des 20 dernières années. On connait le résultat. Pour quelle raison les dépenses de la nouvelle administration seraient-elles donc plus efficaces?
Et puis, n’oublions pas que ces dépenses doivent être financées. Et même si Obama et Ben Bernanke évitent d’en parler, il est clair et inévitable que l’impression de monnaie est l’un des modes de financement retenu. Le processus a d’ailleurs déjà commencé. Il faut donc s’attendre à voir le retour de l’inflation d’ici la fin de 2009. Or, l’inflation est un phénomène sournois, une taxe implicite qui réduit la valeur de nos économies et notre pouvoir d’achat. C’est le cancer de l’économie.
Obama sait pertinemment que ses initiatives entraîneront une douloureuse inflation qui appauvrira rapidement les Américains. Mais, à en juger par les gestes posés, il s’en fiche royalement. Il est déterminé à faire avancer son agenda socialiste, même si ses ambitions occasionnent une destruction de richesses sans précédent.
Les belles paroles d’Obama font rêver beaucoup de gens. Mais le rêve se transformera en affreux cauchemar, ce n’est qu’une question de temps!
Nathalie Elgrably-Lévy est économiste senior à l'Institut économique de Montréal.
* Cette chronique a aussi été publiée dans Le Journal de Québec.