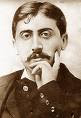Guy Sorman, pour ABC
05 février 2009
La crise économique est aussi une guerre idéologique : sur les origines de la récession, on cherche des coupables et sur les manières d’en sortir, on demande des prophètes. La ligne de front est connue : aux étatistes, elle oppose les libéraux, partisans du marché et de la mondialisation. Pour les étatistes , cette crise sonne comme une revanche après trente ans de domination de la doctrine libérale et de ses succès universels. Les libéraux, ébranlés par une crise qu’ils n’avaient pas envisagée, en sont encore à interpréter les événements : mais la pensée libérale, expérimentale par définition, serait infidèle à elle-même si elle n’évoluait pas. Les étatistes sont, eux, de tradition plus doctrinaire ; envisageons aussi qu’ils représentent les intérêts concrets de la bureaucratie publique. La revanche idéologique des étatistes est une reconquête du pouvoir, tandis que du côté libéral, les intérêts sont dispersés : les libéraux coïncident avec les intérêts des entrepreneurs, mais ne sont pas au service du patronat établi .
Les origines de la crise : est-ce une défaite de la pensée libérale ? Les économistes se querellant encore sur la Dépression de 1930, il paraît difficile de désigner dès maintenant les coupables du krach de 2008. Il n’empêche : pour les étatistes, la crise serait due au manque de réglementation, la faiblesse de l’Etat aurait conduit à l’hyperspéculation. À cette thèse, les libéraux opposent deux arguments. La spéculation immobilière aux Etats-Unis, point de départ de la crise, a été vivement encouragée par l’Etat ; les crédits hypothécaires bénéficiant d’une garantie publique (par les banques Freddie Mac et Fanny Mae), les banques ont prêté et les emprunteurs se sont endettés au-delà du raisonnable. L’Etat aurait donc faussé le marché ! Autre argument libéral : le laxisme de la Banque centrale américaine. Anna Schwartz (cofondateur avec Milton Friedman, de la théorie monétariste) accuse Alan Greenspan et son successeur Ben Bernanke d’avoir inondé le marché d’une quantité de monnaie incontrôlée. Auteur de l’Histoire monétaire des Etats-Unis, Anna Schwartz rappelle que toutes les crises américaines ont toujours été générées par la surabondance de monnaie : elle seule permet la spéculation et les bulles. Réglementer les marchés financiers lorsque ceux-ci croulent sous l’argent, dit Anna Schwartz, est techniquement impossible. Pour cette raison, Milton Friedman recommandait que la monnaie soit gérée selon des critères arithmétiques et non pas au gré de l’humeur des banquiers centraux et des gouvernements.
Les étatistes interprètent donc la crise comme née d’une insuffisance d’Etat et les libéraux , d’une incapacité de l’Etat ; libéraux et étatistes divergent autant sur les solutions. Les circonstances aidant, ce sont aujourd’hui, les étatistes que l’on entend et qui décident ; les libéraux sont relégués dans l’opposition. Dans tout l’Occident (en Asie, on est plus prudent), il n’est question que de réglementation et de dépenses publiques. Par bonheur, nous ne sommes plus dans les années 1930 ni dans l’après-guerre : les appels au protectionnisme, au nationalisme et au socialisme restent ultra minoritaires. Les étatistes ont intériorisé les progrès de la science économique : ils admettent qu’il faut rétablir le marché, pas y renoncer.
Mais en quoi la dépense publique pourrait-elle relancer la croissance ? L’espoir repose sur le « multiplicateur Keynésien » : chaque Euro investi dans l’économie produirait à terme une fois et demie sa valeur et autant d’emplois dérivés. Théorie séduisante , mais envisagée comme fausse dès 1974 par Robert Barro parce que tout Euro investi par l’Etat est soustrait au secteur privé ; or , les investissements publics sont généralement moins productifs que les investissements privés. La dépense publique peut être un facteur de relance , on ne le sait pas par avance ; de manière certaine elle est un transfert de pouvoir des entrepreneurs privés vers les bureaucrates publics. Contre la crise, les libéraux proposent donc, non pas des dépenses publiques, mais des réductions d’impôts durables favorables à l’investissement privé, supposé plus efficace que l’investissement public .
À ces relances , étatiste par la dépense publique et libérale par la baisse des impôts, on objectera qu’elles ne s’attaquent pas à la racine de la crise : la défaillance généralisée du crédit. La crise actuelle est avant tout financière et le restera aussi longtemps que les banques se méfieront les unes des autres ; le crédit ne sera rétabli que par l’élimination des dérivés financiers toxiques qui encombrent les bilans. Faudrait-il nationaliser les banques ? Les étatistes y sont favorables, mais tous les Etats ne sont pas solvables et rien ne garantit qu’une banque nationalisée sera gérée de manière rationnelle. Les libéraux suggèrent plutôt que les dérivés toxiques soient mis sur le marché qui en fixera le juste prix : le risque de cette solution libérale est la faillite de certaines institutions financières. « Mieux vaudrait la faillite d’entreprises mal gérées que de prolonger indéfiniment le gel du crédit », dit Anna Schwartz. Radicalement libérale, elle est favorable à l’application du principe capitaliste de « création destructrice » aux banques : des entreprises comme les autres.
Ces solutions libérales ont été synthétisées dans une pétition en circulation, rédigée par deux Prix Nobel d’économie, Ed Prescott et Vernon Smith. « Tous les économistes ne sont pas devenus Keynésiens, écrivent-ils, et tous ne considèrent pas que la dépense publique améliore la croissance. La dépense publique au temps de Franklin Roosevelt n’a pas sorti les Etats-Unis de la dépression des années 1930. Elle n’a pas sauvé l’économie japonaise dans les années 1990. Croire que la dépense publique aide l’économie, c’est un espoir que contredit l’expérience. Le retour à la croissance exige de supprimer les obstacles au travail, à l’épargne et à l’investissement : en particulier par la baisse durable des impôts. »
Cette pétition est actuellement minoritaire, y compris chez les économistes, sensibles aux vents dominants. Mais en 1930, Jacques Rueff en France et Friedrich Hayek en Grande-Bretagne étaient minoritaires : ils accusaient la théorie Keynésienne de conduire à l’inflation et pas au plein emploi. L’histoire leur a donné raison. Pendant la crise de 1974 à 1979, Robert Barro et Milton Friedman contre le renouveau Keynésien étaient aussi minoritaires, et ils avaient également raison : c’est le retour au libéralisme à partir des années 1980 qui a rétabli l’emploi et la croissance au lieu de l’inflation et du chômage.
Au nom du bonheur commun, souhaitons que les politiques de relance en cours aux Etats-Unis comme en Europe réussissent ; on sait d’expérience, qu’un succès à court terme est possible mais qu’ il serait certainement suivi d’un retour à l’inflation. Il reste donc indispensable de préparer une alternative , ce que Hayek appelait, une utopie de rechange.